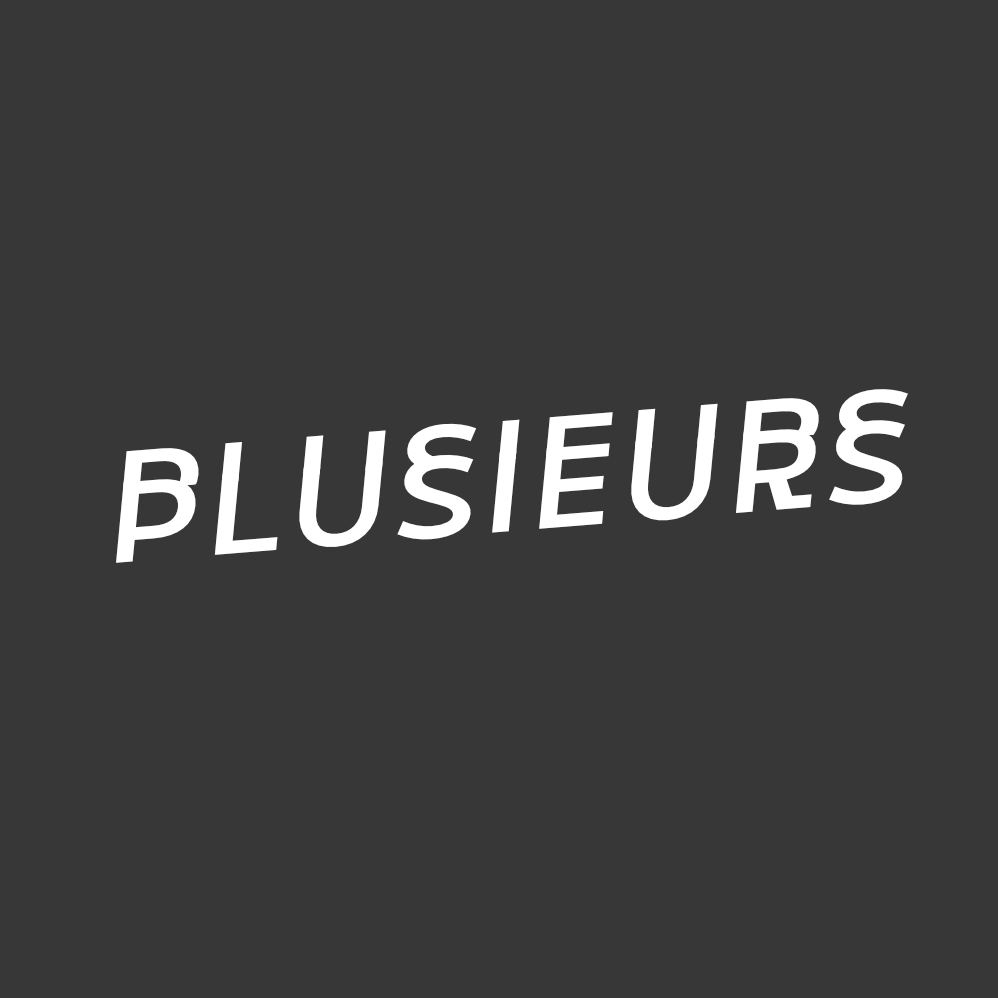Les premiers mots d’Els Moors en tant que Poète Nationale
Il y a cinq ans, j’étais à Berlin et je m’étais endormie beaucoup trop tard, même si je savais que je prenais le risque de rater mon avion le lendemain matin. J’avais à peine de l’argent liquide ce soir-là, mais Catherine, une traductrice britannique de poésie, m’avait offert de partager un taxi pour rentrer à la maison. Catherine était un homme qui, au fil des ans, était devenu de plus en plus femme. Sa voix sonore et son corps fragile me donnaient l’impression que, pour la première fois, je pouvais voir de quelle matière les femmes et les hommes étaient réellement constitués. Et bien que, en temps normal, je ne m’amourache pas des femmes, ce soir-là j’ai ressenti pendant un bon moment l’envie de draguer Catherine. Le lendemain, de bon matin, j’attendais dans la neige le bus qui devait m’emmener à l’aéroport, mais celui-ci tardait à arriver. Le moral en berne, je me suis renseignée auprès d’un chauffeur de taxi qui, à ma grande surprise, a proposé de me conduire gratuitement à l’aéroport. Il m’a raconté qu’il était à la retraite, mais qu’il faisait encore des courses de temps à autre. Ma vaine attente d’un bus en vain, m’assurait-il, lui donnait l’occasion de faire un brin de causette avec les collègues rassemblés à l’aéroport ; et puis il devait de toute façon aller dans cette direction, car il y avait oublié son portefeuille la veille. Incrédule devant tant de coïncidences, je me lançais dans une conversation familière avec cet homme qui, plusieurs années auparavant, avait quitté l’Iran pour l’Allemagne. Il m’a parlé de Rûmî et de Hafez, les poètes persans que tout un chacun se devait d’avoir lu à ses yeux, et de la place centrale qu’occupe jusqu’à ce jour la poésie au Moyen-Orient. En Iran, presque tout le monde possède à la maison des textes de Hafez et, des siècles après sa mort, il est encore fréquemment lu et cité. Pour ses deux filles, il n’avait eu qu’un souhait : qu’elles puissent se marier le plus tard possible, afin de prendre le temps d’étudier et de découvrir par elles-mêmes le chemin qu’elles voulaient emprunter dans la vie. Tandis que les chantiers se suivaient sur notre passage dans le centre-ville de Berlin endormi, nous nous réjouissions à l’unisson d’avoir su éviter les embouteillages. Devant un feu rouge, nous avons commencé à passer en revue l’état du monde et mon chauffeur déclarait un peu las que le monde aurait été tout à fait différent si on avait vraiment donné sa chance à l’expérience du communisme.
Arrivée à l’aéroport et après des adieux prolongés de mon nouvel ami, j’ai compris qu’il me restait encore du temps. Je me suis installée à côté de deux femmes qui étaient assises côte à côte sur un muret et bavardaient à la lumière du soleil levant, sirotant un café brûlant, et je repensais avec plaisir à la conversation dans le taxi. Dans mon enthousiasme, je complimentai l’une de mes voisines pour ses baskets à l’allure festive. Flattée, la femme me demanda aussitôt si je voulais surveiller un instant sa cargaison de bouteilles, le temps qu’elle aille à son tour prendre un café avec sa copine. J’avais déjà été surprise par la quantité de bouteilles vides qui sortaient du chariot et du caddy, mais j’avais omis de m’appesantir sur cette question. Tout le monde ne trimbalait-il pas l’une ou l’autre cargaison avec soi dans un aéroport ? Lorsque, restée seule, j’attendais le retour des deux femmes et que je me retrouvais à encaisser tant et plus de regards ahuris des passants, j’ai fini par comprendre : je n’avais pas remarqué que ces femmes étaient probablement des sans-abri et l’on me prenait à présent pour une clocharde, cachée derrière une valise à roulettes et un tas de bouteilles vides, pour lesquelles j’aurais d’ailleurs pu récupérer la consigne. Sans m’en apercevoir, j’avais traversé la frontière avec cet autre côté d’une civilisation, que je croyais connaître mais que je n’avais pourtant jamais auparavant observée depuis ce point de vue. J’ai vu les préjugés de la communauté dont je pensais faire partie, des préjugés qui avaient toujours obscurci mon regard et que, pour la première fois, je voyais clairement dans ces yeux qui me fixaient.
Et voilà que, tant d’années plus tard, au moment où je décide de commencer ce discours par ces événements-là, je me rends compte que Catherine et le chauffeur de taxi et les deux clochardes et moi étions tacitement d’accord sur une chose. Des mots comme « homme » et « femme », « capitalisme », « communisme », « communauté » et « individu » ont la tendance tenace à vouloir s’exclure mutuellement, comme s’ils pouvaient seulement fonctionner de façon totalitaire et ne toléraient aucune coexistence. L’on pouvait imaginer des milliards de variations sur le corps masculin, mais aucun ne s’était spontanément transformé en un corps de femme. Je me souviens très bien du moment où, devant un aquarium, je me suis trouvée face à un poisson asexué qui s’avérait, par une voie détournée, capable de reproduction. Pour les besoins de ce discours, j’ai essayé de retrouver le nom de ce poisson. Lorsque j’ai googlé « poisson qui n’a pas de sexe », le texte suivant est apparu en haut de la liste de résultats : « Angelina Jolie a aussi prêté sa voix au poisson Lola dans le film d’animation ‘Gang de Requins’ (2004) de DreamWorks » etc.
Mais revenons à nos moutons. Tout comme les mots « homme » et « femme » souhaitent s’exclure l’un l’autre, l’on peut imaginer des centaines de variantes du capitalisme, mais aucune d’entre elles ne risque de se transformer spontanément en une sorte de communisme. Sans doute est-ce précisément notre variante démocratique occidentale du capitalisme – un communisme qui cache son nom –, qui continue de nous leurrer par sa pseudo-équité et nous pousse à nous raccrocher obstinément à cette méprise catastrophique. Au plus profond de chacun de nous, l’idée de ce que devait être un monde juste s’était enracinée, se faisant toujours plus intransigeante, comme un mensonge tenace. Pour savoir quel type de femme Catherine était devenue – et pour l’aimer – j’aurais dû d’abord moi-même me transformer radicalement. Et l’histoire avait démontré elle aussi que la révolution copernicienne proposée par le communisme était vouée à l’échec, une fois appliquée à grande échelle. Je ne pouvais pas me changer et je ne pouvais pas davantage demander à Catherine, qui se sentait femme, de rester un homme pour me permettre à moi de rester inchangée. Autrement dit, exiger que le monde capitaliste trouve la bonté en lui-même, tout simplement parce que nous trouvions qu’il avait assez tardé à nous montrer un visage plus humain, revenait à croire en un dieu cruel.
De la même manière, il m’a semblé dans un premier temps impossible d’accepter la fonction de Poétesse Nationale, pour n’avoir pas préalablement conduit dans ma vie ou dans celle de la Patrie certains changements urgents et radicaux. Dans cet état d’esprit, j’ai commencé à lire des textes de poètes qui s’étaient déjà adressés au peuple et à la patrie, comme j’étais à présent censé m’adresser au peuple, à supposer que j’accepte cette charge. J’ai constaté, non sans étonnement, que les poètes avant moi avaient eux aussi senti une gêne à l’idée de s’adresser à la communauté. Et ce n’était pas tout. Apparemment, une guerre de tous les instants opposait depuis des siècles les poètes et les communautés qui les entouraient ; une guerre qui avait déjà abouti, il y a plus de 2 000 ans, à la proposition de bannir une fois pour toutes de l’État tous les poètes. Si le raisonnement de Platon peut paraître une surprise cruelle et une amère fatalité, en 1927 il était clair pour Paul van Ostaijen, un des poètes flamands modernes les plus connus, que « tout ‘vrai poète’ comprenait naturellement le postulat platonicien d’un État désireux de se débarrasser des poètes ». En artiste de gauche, j’aspire moi aussi à mettre de la légèreté dans une opposition pure et dure, mais il me semble que, eu égard à notre gouvernement actuel – dangereusement à droite, défaitiste, apolitique et esquivant toute responsabilité vis-à-vis de l’histoire –, ce rôle ne mérite aucun éloge et encore moins le titre de Poétesse Nationale. C’est tout simplement une question de bon sens. Voici ce qui m’inquiétait au sujet du titre de Poétesse Nationale : peut-être était-il grand temps que j’admette – au moins à moi-même – que je ne voulais plus écrire que des poèmes antiétatiques, qu’une fois pour toutes j’applaudirais avec passion à la mise au ban de l’État proposée par Platon. Non seulement étais-je une fois de plus accablée par ma condition de femme, jugée superflue et sans cesse diabolisée par la société, qui entraverait à jamais toute possibilité d’amour entre Catherine et moi ; non seulement me suis-je avérée incapable de défendre une forme démocratique de communisme face au capitalisme cruel, fût-ce avec l’aide d’un téméraire chauffeur de taxi ; mais, à mon grand dam, voilà qu’en plus je succombais à la pression d’une patrie imaginaire et d’un illusoire statut de poète. On n’est son métier qu’à partir du moment où on l’exerce, m’avait toujours prévenu ma mère. Les mots Poétesse Nationale me pousseraient-ils à être poète en dehors du temps de l’écriture ? J’avais soudain l’impression de ne pas avoir eu conscience, pendant toutes ces années, de ce que j’avais réalisé.
C’est une rencontre inattendue qui m’a tirée de cette impasse. Il y a quelques semaines, l’antiphilosophe français Alain Badiou était venu parler de son livre Que pense le poème (2016), à l’invitation notamment des Midis de la Poésie. Il faut savoir que j’ai toujours considéré que, devant de grandes difficultés, il valait toujours mieux consulter un philosophe qu’un poète. Aussi étais-je surprise d’apprendre qu’un antiphilosophe comme Badiou défendait la thèse opposée. Un philosophe avait tout intérêt, selon lui, à consacrer un livre entier au poème et, partant, à la poésie ; et il ne rechignait pas à défendre ce choix devant un public bruxellois. Que pense le poème est un recueil de conférences et d’essais qu’Alain Badiou a consacrés au fil des ans au sujet de la poésie. Dans ces textes, il définit le poème et, partant, la poésie en les plaçant directement aux côtés de la philosophie, en tant que bâtardise ou falsification du langage et de la pensée philosophiques. Selon lui, la pensée représentée par la poésie doit être considérée comme une action. Cette pensée ne se rapporte pas à la connaissance et c’est une pensée qui aspire à demeurer sans objet parce que son objet est précisément de tenir en échec toute forme de raison. Dans notre monde contemporain, affirme Alain Badiou, la poésie s’éloigne hélas de plus en plus de nous, parce qu’elle supporte mal qu’on exige d’elle la clarté. La poésie s’oppose à l’audience passive, au message simple. Au contraire, dit-il, le poème est un exercice intransigeant. Il est sans médiation et il est aussi sans médiatisation. Le poème reste rebelle – d’avance vaincu – à la démocratie du sondage de l’audimat, soutient encore Alain Badiou.
Ce n’est qu’un échantillon des qualités invincibles que l’antiphilosophe attribuait à la poésie et au poème, et jamais auparavant n’ai-je eu l’occasion de lire dans une langue aussi brillante ce que le métier de poète signifie pour moi. Il n’empêche que chacune des qualités spécifiques qu’Alain Badiou accordait au poème était tout aussi valable et insaisissable que l’amour même. L’amour, lui aussi, avait naturellement l’esprit de contradiction et aimait par-dessus tout à se jouer du bon sens. Il ne se laissait pas appréhender par des moyennes ou des formules, et il menait le plus souvent à la ruine complète, comme plus d’un barde en avait déjà fait l’amère expérience. Qu’Alain Badiou considérât la poésie comme tout aussi irrationnelle, libre et indifférente était pour moi un désenchantement. Je craignais que ce faisant il ne laissât la poésie à la merci de considérations partisanes entre believers et non-believers. Après tout, dans notre monde les femmes et les enfants sont toujours censés savoir ce qu’aimer veut dire, et c’est bien pour cette raison que nous sommes invariablement gouvernés par des ordures sans cœur.
Devais-je élargir la définition des mots « amour », « capitalisme », « poésie », « patrie » jusqu’à ce que chacun soit assez grand pour nous souder à jamais les uns aux autres, au mépris de toutes les contradictions inconciliables ? Alors que je commençais, en pensée, à élargir avec mes mains, évidant la terre comme un mineur, ce tunnel imaginaire que sont les mots, je fus frappée par l’absurdité d’une telle entreprise. Sans aucun doute il y aurait d’autres Catherine, d’autres que je ne pouvais pas encore anticiper et qui m’inciteraient à creuser de nouveaux tunnels encore plus larges – un travail de Sisyphe auquel je préférais, quoiqu’il fût réalisé au nom de la patrie, renoncer sur-le-champ en raison de ma nature paresseuse. Était-il concevable que Catherine et moi nous fussions aimées pendant tout ce temps, mais que c’était précisément le mot « amour » qui nous avait barré la route ? Pouvait-on justifier un tel renversement des choses ? Dans ce cas, pas plus de 1 % de la population mondiale n’était disposé à se retrancher derrière le capital tout entier de ce monde régi par l’esprit de partage. Les 99 % restants juraient fidélité à la pauvreté et de plus, décidai-je contre toute raison, ces 99 % paieraient, au péril de leur vie et avec le peu d’argent qu’on leur avait laissé, volontairement de leur poche toutes sortes de politiciens et d’individus qui prétendent s’y connaître, afin de garder à distance à tout le moins les gros salaires les moins scrupuleux et les plus grandes crapules. Existait-il quelque part dans le monde une patrie et une langue maternelle assez puissante et inspirante pour m’astreindre à l’état d’alerte de la poésie éveillée ? Si j’avais réussi à aimer les gens et à écrire des poèmes pendant toutes ces années, c’était justement parce que j’avais eu la chance de bénéficier d’impressionnantes défaillances de ma mémoire à long terme. J’oubliais chaque poème avant même de l’avoir écrit, ce qui m’obligeait à en écrire sans arrêt de nouveaux, et seuls les amants les plus ennuyeux restaient pendus à ma sonnette, même si on avait rompu depuis longtemps. J’avais réussi, au fil des ans, à contourner avec toujours plus d’habileté toute forme de patrie ; une prouesse dont j’étais peut-être encore plus fière que des quelques poèmes que j’avais pu écrire. « Poésie », « patrie », « amour »… À supposer que je me sente attirée par ces mots, j’aspirais encore davantage à fuir éternellement leur intransigeance. Les mots « amour » et « poésie » et « patrie » se tenaient entre les gens et les choses comme des ponts apparemment praticables. À ce titre, ils étaient tout aussi faciles à traverser qu’à faire sauter. Si je l’avais voulu, j’aurais pu effectuer la traversée vers Catherine, auquel cas j’aurais misé sur le mot « amour », sachant que Catherine se trouvait de l’autre côté. Cette conscience aurait été une expérience immédiate, qui n’aurait requis aucune réflexion. En l’occurrence, j’aurais vu le pont de l’amour avant même qu’il ne se matérialise et je l’aurais traversé sans réfléchir. Mais si le pont de l’amour faisait le lien entre deux individus, que pouvait bien relier le pont de la poésie ? Van Ostaijen avait commencé à s’adresser à la société en poète pour ensuite, dépité, tourner le dos à cette même société : « Donc, si je fais de la poésie, c’est parce que je suis certain de n’avoir rien, mais absolument rien à dire ». Devais-je en conclure que le pont de la poésie entre le poète et la communauté était, tout comme l’amour, un pont trompeur et périlleux ? Un pont dont un poète connaîtrait dans le meilleur des cas les coordonnées, mais contre lequel il tenterait en même temps de prémunir les lecteurs ? Ce pont était-il devenu si étroit et infranchissable à cause des poètes mêmes qu’il valait mieux ne pas en risquer la traversée ? Mais dans ce cas, qu’est-ce qui était véhiculé par la langue ? Si j’aimais Catherine et que je tentais la traversée à l’aide du mot « amour », que transportais-je à part moi-même ?
Peut-être ma connaissance limitée de la philosophie commençait-elle à me jouer des tours durant ma lecture d’Alain Badiou. Peut-être étais-je trop poète pour pouvoir regarder la poésie avec suffisamment de distance philosophique. Je m’égarais de plus en plus. Jusqu’à ce matin où je me suis réveillée et ai décidé de suivre l’exemple de Badiou en cédant à la pression de la Patrie. Je redéfinirais ma poésie en la repositionnant au nom de la patrie. Badiou définissait la poésie en la disant corrompue et en la situant juste à côté de la philosophie. S’il devait exister en ce monde un pont imaginaire reliant le mot « communauté » avec le mot « poésie », me dis-je, alors n’avais-je pas été moi-même ce pont pendant tout ce temps ? D’un côté du pont, décidai-je, il y avait la langue et cette langue appartenait à la communauté. J’avais entendu et cueilli cette langue et à la longue, par curiosité, au petit bonheur la chance, je m’étais fait pont pour porter certains éléments vers un autre côté imaginaire. Ou peut-être avais-je imaginé que je devais travailler mon corps jusqu’à ce qu’il devînt langage ? Pourquoi ? Probablement mon comportement devait-il aussi être qualifié de corrompu et de symptomatique. Il n’y avait pour moi pas d’autre façon de combattre la maladie imaginaire dont je croyais souffrir et que j’aurais aimé décrire dans mes moments les plus sombres par le mot « communauté ». Où espérais-je aboutir – en tant que pont ? Où se trouvait l’autre côté ? La réponse, me dis-je un peu tristement, aurait chaque fois, avec chaque nouveau poème et chaque nouveau poète, un visage différent. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais au fond écrit ce discours pour Alain Badiou. Il avait donné à son livre le titre poétique Que pense le poème ? pour ensuite démontrer tout au long du livre que le poème ne pense pas mais fait. Il considérait les poètes comme des philosophes ratés qui étaient enfermés dans un corps de poète et ne pouvaient s’empêcher de philosopher de façon corrompue. Lorsque j’ai voulu lui faire dédicacer mon livre après la conférence, j’ai trouvé qu’à son tour il ressemblait davantage à un poète corrompu qu’à un philosophe. Il transpirait encore un peu, affichait un sourire boudeur et vérifiait avec insistance l’orthographe de mon prénom avant d’entamer, le regard tourmenté, la tâche humiliante de la dédicace à l’encre noire. Je connaissais bien ce regard. Pour ceux qui aiment vraiment le papier, couvrir de banalités la dernière page vierge de leur propre livre sur ordre d’un étranger est une véritable catastrophe. Je tentais d’épeler mon nom à voix haute, mais j’étais trop loin pour que Badiou, un charmant vieillard aux sourcils et poils de nez fort longs, puisse m’entendre. Un gars costaud placé un peu plus près se proposa comme médiateur, même si je voyais à son regard qu’il était lui aussi d’avis qu’il manquait à « Els » un « e » ou un « a ». Un prénom, nous disait Badiou d’un regard sévère, est d’une importance vitale. Je ne veux pas avoir mal orthographié un tel prénom. Il n’en écrivit pas moins : « Pour Els (e) », avec un « e » de trop, et puis « un jour à Bruxelles… trois points, Alain Badiou ». Cette dédicace mystérieuse est, je le comprends maintenant, le plus beau et le pire poème que je n’aie jamais lu. Mais il prouve surtout le dernier point que je voulais soulever. À savoir que cela ne me dérange pas que Badiou estime que les poètes doivent toujours demeurer des philosophes ratés. Pour ma part, je suis d’autant plus consciente de ce qu’en chaque philosophe génial se cache pour toujours un poète raté. Mais un jour, je voudrais demander à Alain Badiou pourquoi il n’a pas observé que tous les poètes devraient être bannis de l’État parce qu’ils se sont toujours, sans exception et de leur plein gré, laissés corrompre par l’amour.
Mon rôle de Poétesse Nationale a d’ailleurs commencé l’année dernière lorsque j’ai été invitée à participer au projet « Tour de Belgique », en tant qu’ambassadrice de Laurence Vielle, la précédente Poétesse Nationale. Laurence rêvait de combiner la dimension manuelle du poète pensant dans sa langue maternelle avec un véritable exercice de pensée pour les pieds, et ce en traversant l’espace tangible de notre patrie déchirée. En raison de l’impact que ce périple a eu sur moi je souhaite partager le résultat de ce voyage sous la forme de mon premier poème offert à la Patrie. Outre la production bimensuelle d’un poème, je continuerai non seulement à soutenir les projets enthousiasmants qui ont déjà été mis en place, tels que Belgium Bordelio, mais au cours des prochains mois j’aimerais aussi réfléchir tout haut à plusieurs autres projets que j’espère réaliser avec vous. Une Poétesse Nationale mérite une résidence royale. Aussi préparons-nous une collaboration avec la section bruxelloise de Natuurpunt et l’Hippodrome (de Boitsfort, N.D.T.) visant à créer une résidence d’écrivains dans la tranquillité de la Forêt de Soignes, à savoir dans la Loge Royale, d’où Léopold II regardait les courses de chevaux. Avec Laurence Vielle, j’aimerais donner suite à une invitation du chef d’orchestre Guy van Waes : remplacer les paroles du Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze de Haydn par sept textes contemporains, qui seront chantés aux sons d’un pianoforte viennois de 1790. Je souhaite mettre en place une coopération définitive entre le Poète National et la communauté germanophone de Belgique, où j’ai été chaleureusement accueillie par le Medienzentrum lors de mon Tour de Belgique. Je veux en outre rassembler des ressources pour organiser, avec la communauté arabe, un nouveau festival biennal de poésie arabe à Bruxelles. Mohamed Ikoubaân, le directeur du festival Moussem, a récemment fait valoir dans le journal De Standaard que l’arabe était la quatrième langue la plus parlée à Bruxelles, mais que dans la vie quotidienne l’acceptation de l’arabe ou d’autres langues étrangères laissait encore à désirer. Il va de soi, rappelle Mohamed, qu’une ou plusieurs langues communes sont nécessaires pour communiquer et vivre ensemble dans un pays. Mais rien ne nous empêche d’apprécier les langues des nouveaux venus et de leur faire une place. En tant que poète, je veux aussi donner suite à cet appel – et à d’autres lancés précédemment – visant à ne pas réduire l’arabe à sa seule fonction de langue du Coran et de l’islam. Sans doute doit-on avoir vécu soi-même assez longtemps à l’étranger pour comprendre l’impact d’une vie publique qui ne se déroule que dans d’autres langues maternelles. J’ai longtemps vécu à Amsterdam et, durant les premières années, il m’arrivait d’avoir les larmes aux yeux dans le train vers la Belgique, lorsque j’entendais quelqu’un parler flamand après des semaines passées au sein de la diaspora hollandaise. Imaginez : vous êtes né sourd et vous lisez un poème pour la première fois. Il n’est pas impossible d’imaginer qu’un tel poème résonne énormément dans vos oreilles. Qui sait, une langue maternelle fonctionne selon le principe opposé. C’est le son silencieux, voire inaudible, mais non moins tendre des premiers mots avec lesquels tout être humain a été invité au langage. Chacun, partout dans le monde, a le droit de retrouver ce silence encourageant et j’estime que le projet du Poète National peut contribuer à toujours faire résonner ce même silence en même temps et dans le plus grand nombre de langues possibles.
Tout d’abord, je remercie la Loterie nationale et ses opérateurs, ainsi que l’Accord de coopération culturelle entre la Communauté flamande et la Communauté française, pour le soutien financier qu’ils apportent à ce projet, et j’aimerais conclure ce discours par deux citations de mes prédécesseurs. Charles Ducal a écrit : « Pour nous, organisateurs, poètes, traducteurs et toutes les personnes impliquées, la fonction du Poète National répond à notre propre intérêt bien compris. Elle donne à la poésie l’occasion de défendre son existence comme une évidence, bravant toutes les indifférences et minimisations. » Quant à Laurence Vielle, elle observait il y a deux ans : « Puisse ce projet nommé Poète National, Dichter des Vaderlands, der Nationale Dichter, continuer à être un mouvement solidaire et sans frontière d’une réévolution poétique, passerelle vive entre toi et moi ! » Poète National est avant tout un projet commun et enthousiasmant d’une communauté évidente mais non moins solidaire, et cette communauté ne cesse de s’agrandir. Je suis heureuse de pouvoir travailler avec ces partenaires indispensables du Pays du Poète National, à savoir le Poëziecentrum de Gand avec Carl, Lot, Sieglinde et Stefaan ; VONK et Zonen avec Michaël et Lotte ; Passaporta avec Ilke et Adrienne ; le collectif de traducteurs avec Pierre, Isabel, Danielle, Bart et Katelijne; les Midis de la Poésie avec Mélanie ; et maelstrÖm reEvolution à Bruxelles et la Maison de la Poésie d’Amay avec David et Simona, la Maison de la Poésie Namur avec Charlotte, Aline, Anne et Manon ; Théâtre Poème 2 avec Dolorès et Elsa ; et Jeugd en Poëzie avec Flore ; et toutes les personnes s’investissant directement ou indirectement dans ce projet que j’aurais pu oublier ici. Cela me donne du courage de vous savoir confiants que je n’aggraverai pas cette erreur louable d’être votre Poétesse Nationale, enfin pas au-delà de ce que les circonstances actuelles rendent plus ou moins nécessaire. Je tiens à remercier de tout cœur Laurence Vielle et Charles Ducal d’avoir précédemment assuré le rôle de Poète National avec tant de fougue. C’est votre témérité qui me donne aujourd’hui le courage de dire oui.