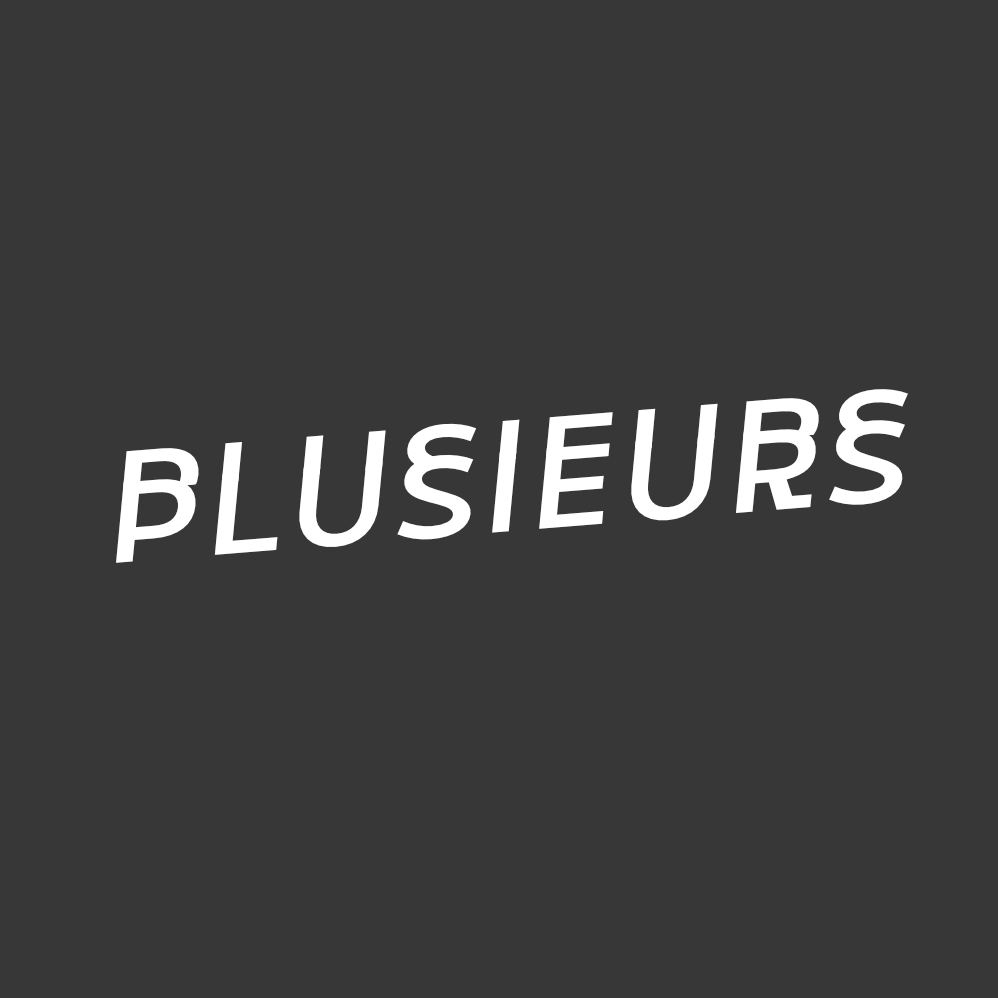Pour Martine et en amitié avec Ludivine
Nous sommes à portée d’un souffle,
ce seul souffle qui nous sépare devient un monde.
Nous sommes à portée d’un battement,
ce battement, où que le cœur se pose,
en son absence soudaine devient un monde.
Mais j’étais à tes côtés, souffle et battement,
ciel dans la main, partage de chaleur.
Tu as franchi le seuil, j’étais là
comme tu le fus, toi qui vivais pour les autres.
La nuit ne sera jamais une couverture
pour celle qui la drape seulement,
par les mots, de transparence.
Sans pathos, ni ostentation,
nous voilà,
simplement, comme tu l’aimais :
être au cœur des choses,
avec cette façon d’être au jour
à la fois discrète et intense.
Avant de rejoindre la vague, tu as dit :
« J’ai fait tout ce que je voulais faire ».
Tu n’es plus là, mais nous sommes.
Au bout du souffle, du battement,
où que le cœur se pose.
Nous sommes à portée d’une main,
le ciel de ta main, ta main qui moissonnait,
pour toujours au cœur de la mienne
les enfants que tu aidais sont au bout de mes lèvres
et je contemple l’horizon pleine de ton regard
Nous regardons le monde
Je compte le temps qui file
le temps qui nous sépare qui s’égrène et se compte
le temps qui nous rapproche
car à l’horizon de la vague
nous sommes unies je le sais
tu es la fleur du bouquet de ce jour
et la lumière de ce ciel,
l’air très doux nous caresse.
Nous sommes à portée d’un souffle
ce seul souffle qui nous sépare devient un monde.
Et c’est le nôtre, maman, pour toujours notre monde,
offert au monde entier.
Tu es à mes côtés
souffle et battement, transparence,
ciel dans ma main, partage de chaleur.
Toi qui as tant donné,
ton don tant que je vis
ne cessera de croître.
Maman, merci.