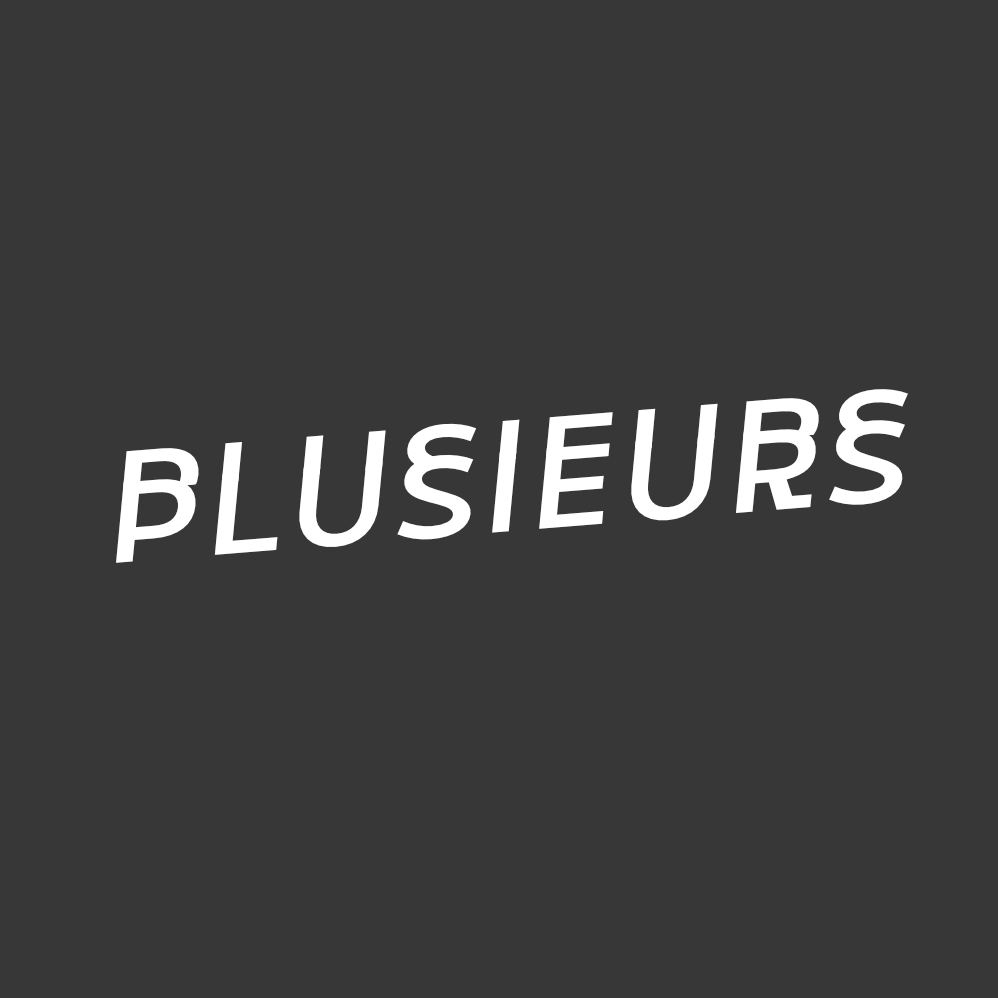Pour Jean-Claude Crommelynck
Eh, copain, ami,
J’ai tourné retourné des vers
Dans un terreau de larmes
De mots convenus sur des airs d’église
Ecrit ligne à ligne des poèmes de départ
Mais merde quoi
Que ferais-tu vraiment
D’un poème de départ
Un poème-couronne pour fleurir ton absence
Pour évoquer tes jours comme jauniraient tes livres
Souligner le silence qui se colle à tes pas
Pleurer sur ton blouson la cigarette absente
S’apitoyer enfin sur ta voix qui s’est tue
Allez
J’entends ton rire gonfler le vent
Eh, camarade, ami, je ne veux pas ne veux pas non
Ecrire des vers comme on regrette ou comme on pleure
Des vers comme il pleut sur les mots
Des vers comme ça quoi sérieusement
T’en aurais fait
Bois pour le feu
Le cœur serré tous tes copains
Battent tambour pour ton départ
Tous les copains, les camarades,
Chopent tes vers comme des parpaings
Tous tes copains, tes camarades,
Se tiennent droit.e.s sur le pavé
Et font putain monter un chant
À creuser des trous de lumière
À même les collines du Néant
Ecoute un peu putain leur voix
Ecoute un peu comme c’est la tienne
Ecoute un peu ça qui vrombit
Qui grouille pour te donner racines
Pour te faire arbre parmi les arbres
Pour te porter comme un fanal
Ecoute un peu sûr que leurs vers
Se parfument pas à l’hémistiche
À la césure, à la rimes riches,
À la charogne d’un sonnet,
On bat tambour, on gueule j’te dis
On gueule tes mots comme tu tenais
Tête à la mort,
Tête à l’immensité du vide
Tête aux refrains des plaines mornes
Tête à la fatigue édentée
Tête aux logiques mercantiles
Tête à tout quand tout méprise
Arrache, insulte, profane, écrase
Tête à ce qui
N’est pas lumière
Tête, tête, tête, tenir tête
Tête, tête, tête, tenir
Eh, copain, camarade
Tu nous auras appris
Qu’on peut tenir, putain
Tenir
Et là
Tu vois
Si nous tenons
Malgré le choc
Malgré l’ébranlement certain
Qu’a provoqué ta volte-face
Si nous tenons
Pour peu qu’on tienne
C’est qu’aujourd’hui
On prend exemple
Ceejay
Sur tes racines
On se plante profond
On s’enracine
Puis quoi on fait bouger nos branches
Pour un salut à la hauteur
Des cimes où t’as posé ta voix